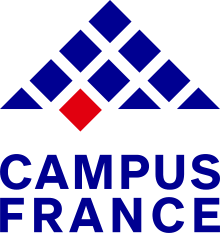Journée internationale des Droits des femmes : égalité, mixité et santé dans l’enseignement supérieur
A l’occasion du 8 mars, Journée internationale des Droits des femmes, le ministère français chargé de l’égalité a choisi de valoriser les actions existantes, issues du plan interministériel Toutes et Tous Egaux, menées autour de trois thématiques : les mesures en faveur de l’égalité professionnelle, la diffusion de la culture de l'égalité, la promotion de la santé des femmes. Autant de mesures qui concernent, chacune à leur niveau, le monde de l’enseignement supérieur.
« Les inégalités entre les femmes et les hommes sont anciennes, ancrées. Elles imposent non seulement des actions fortes, constantes, résolues, mais aussi des changements culturels profonds dans tous les pans de notre société ». Partant de ce constat, le plan gouvernemental Toutes et Tous Egaux, lancé en 2023, a pour but de renforcer et d’accélérer l’action gouvernementale dans tous les domaines et notamment celui de l’enseignement supérieur et de la vie étudiante.
Des secteurs professionnels trop masculinisés
Premier domaine, celui de l’égalité professionnelle. L’égalité professionnelle et l’autonomie économique des femmes sont en effet « les conditions premières de l’égalité réelle entre les femmes et les hommes ». Parmi les nombreuses mesures déjà prises, déclinées par le plan et reprises par le ministère, on retiendra les efforts faits en matière de mixité des métiers. Afin de « promouvoir l’entrée des femmes dans les secteurs les plus masculinisés », le plan Toutes et tous égaux prévoit :
- de favoriser la place des femmes dans le secteur industriel, avec un temps fort, la Semaine de l’industrie et le collectif Industri'Elles qui, en 2024, ont organisé plus de 1000 événements consacrés à la mixité des métiers et à la sensibilisation des jeunes filles à l'industrie ;
- d’apporter un accompagnement global à 10 000 jeunes femmes désirant poursuivre des études supérieures dans les filières de la tech et du numérique « en agissant sur l'ensemble des freins identifiés ». A cet effet, un programme Tech pour toutes devrait être lancé en 2025 ;
- de créer une plateforme de mentorat accessible gratuitement à toutes les femmes, ouvrant à l’ensemble des métiers, en leur proposant un accompagnement personnalisé dans le cadre de leur développement professionnel.
L’éthique et le respect dans l’enseignement supérieur
Deuxième axe, diffuser la culture de l’égalité qui « passe par l’éducation au respect mutuel ». C’est d’abord prendre conscience que « les stéréotypes de genre attribuent des rôles et des fonctions prédéfinis aux femmes et aux hommes, dans la vie professionnelle et privée ». Pour permettre aux filles et aux garçons « de se libérer de ces représentations qui pèsent sur leurs choix et limitent le champ des possibles, il est essentiel de promouvoir la culture de l’égalité ». Si la première des mesures de cet « objectif mixité » est encore d’accentuer la mixité dans les filières scientifiques du supérieur, d’autres mesures concernent d’autres aspects de l’égalité :
- l’éthique, avec la mobilisation des établissements de l'enseignement supérieur pour instaurer une « charte éthique » en faveur de l'égalité, dans tous les établissements de l'enseignement supérieur, notamment artistique et culturel ;
- le respect, avec la lutte contre les violences sexuelles et sexistes dans l’enseignement supérieur, en créant des lieux d'écoute et d'accompagnement ouvert aux victimes et témoins de violences sexistes et sexuelles dans chaque université. Parallèlement, une campagne de sensibilisation sur les violences sexistes et sexuelles dans les universités a été lancée, en collaboration avec les organisations étudiantes.
La santé à chaque étape de la vie
Promouvoir la santé des femmes, c’est d’abord favoriser l’accès aux droits et, en premier lieu, « garantir aux femmes le droit à disposer de leur corps » et en particulier aux jeunes femmes. Dans ce cadre, l’extension de la gratuité de la contraception et du dépistage a été étendu à tous les jeunes jusqu’à 26 ans. Cette mesure concerne 3 millions de jeunes femmes.
Plus précisément, ont été mis en place :
- la contraception d’urgence, gratuite et accessible sans ordonnance en pharmacie pour les mineures. Pour les majeures, elle est disponible en pharmacie sans ordonnance et prise en charge à 100% sur présentation de la carte Vitale ;
- l’accès généralisé au dépistage sérologique du VIH, possible dans tous les laboratoires de biologie médicale sans ordonnance, sans rendez-vous, sans avance de frais et avec prise en charge à 100%. L’élargissement du dépistage à d'autres IST est aussi possible, dans les mêmes conditions de prise en charge.
- la gratuité des préservatifs masculins et féminins jusqu’à 26 ans ;
- des actions de communication et en particulier une campagne nationale sur la contraception.
Des données chiffrées sur la féminisation dans l’enseignement supérieur et la rechercheC’est encore à l’occasion de la Journée internationale des Droits des femmes que le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche publie sa 9e édition du recueil « Vers l’égalité femmes - hommes ? Les chiffres clés de l’enseignement supérieur et de la recherche ». Il s’agit de données « détaillées et objectivées sur les différences genrées » observées dans le champ de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Parmi ces données :
|
Sur le même sujet
- Consulter le site du ministère chargé de l’égalité entre les femmes et les hommeshttps://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/8-mars-2025-journee-internationale-des-droits-des-femmes
- Consulter la publication du ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherchehttps://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/vers-l-egalite-femmes-hommes-chiffres-cles-2025-98689
Actualités recommandées